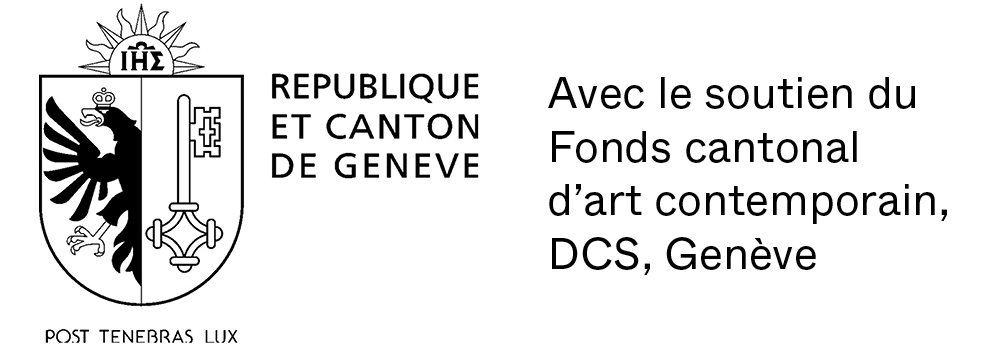Alihou Ndiaye – Thiès, Sénégal
9 février 2020
Alihou est coordinateur de l’Association sénégalaise de producteurs de semences paysannes, ASPSP.
Le métier de semencier et ses difficultés
Si l’on n’est pas semencier aujourd’hui notre raison d’être en tant qu’humain disparaît. Sans cette pratique, il n’y a pas de survie économique.
L’échange de semences est intense au niveau local à travers la pratique du don. La traçabilité est assurée dans le circuit court, A donne des semences à B. B les cultive et rend une partie de sa récolte de graines à A. C’est un réseau puissant de par sa légèreté. Il fonctionne sans argent.
Dans la chaîne de production traditionnelle de la semence, le paysan est seul, il n’y a pas de segmentation. Il entretient, récolte, trie et conserve.
Dans la chaîne de production industrielle, le paysan est cantonné à une seule étape, la quatrième, la multiplication. Il est ramené au statut de simple ouvrier de la chaîne.
La situation contemporaine est liée avant tout à la colonisation en tant que processus de domination mentale.
La principale difficulté vient de la loi qui lie la production de semences à la possession d’un certificat délivré par une instance étatique. Le paysan qui produit ses semences dans la tradition se retrouve hors-la-loi.
Le métier d’artisan semencier n’est pas reconnu, bien que 80 % des semences utilisées au Sénégal soient produites par les paysans. Formellement, les artisans semenciers se retrouvent dans l’illégalité.
Cette définition juridique favorise les firmes internationales comme Tropicasem ou Vilmorin qui remplissent les critères juridiques liés à la commercialisation des semences. Les produits de ces firmes s’accompagnent d’un paquet technologique, comprenant notamment engrais chimiques et pesticides, qui porte atteinte à la qualité des sols et implique l’utilisation de matériel agricole, l’aménagement du terrain et l’abattage des arbres pour permettre le passage des machines.
A ce jour, il n’existe pas de filière organisée de vente des semences traditionnelles. La loi interdit l’ouverture d’une boutique de vente ou la tenue d’un catalogue. Pourtant, les coûts de production des semences dans la filière industrielle sont plus élevés que dans la production traditionnelle. Face à cette situation, la nécessité de peser politiquement devient une priorité pour l’ASPSP et les autres associations.
Le marché
Dans les régions très maraîchères, l’échange monétarisé prime. Dans les régions périphériques, l’échange traditionnel domine. Dans les villes, c’est la production industrielle qui tient le marché.
Au marché populaire, ce sont surtout des intermédiaires qui tiennent boutique. Ce sont eux qui fixent les prix. Le paysan n’a pas accès au marché pour vendre sa production, exception faite du marché bio. C’est un problème. Pour faire évoluer la situation, nous travaillons autour de la logique de paniers, de marchés paysans bio et de la création d’un label.
Le grenier
Dans de nombreuses régions, le savoir-faire entourant le stockage des semences a disparu. Le système des greniers traditionnels construits dans les mares ou les marais est tombé en désuétude. Ces greniers sont remplacés par des centres de conservation construits par l’état.
Face à ce problème, on a identifié des personnes qui ont gardé ce savoir traditionnel pour transmettre à des groupes de femmes ces techniques de construction d’espaces de stockage et de conservation des récoltes et semences pour l’économie familiale. On a utilisé ce thème durant les foires autour de la pertinence des greniers.
Traditionnellement, ce type de greniers était construit par les femmes. On a travaillé dans une vision de transfert de techniques, on a mélangé les techniques bobo et mandingue pour construire de nouveaux prototypes de greniers traditionnels. En fusionnant ces deux traditions, on a amélioré ces constructions.La place de la semence, c’est la terre, pas le grenier. La semence doit retourner fréquemment à la terre pour se revigorer. Plus une semence retourne à la terre, plus elle reste vivace. Chaque année, chaque variété doit être replantée. Mais ne mettez jamais à la terre toutes vos semences.
Beate Schierscher-Viret – Agroscope de Changins
Beate est agronome. Elle travaille à l’Agroscope, où sont menés différents projets de recherche agronomique de la Confédération suisse, à Changins. On y trouve aussi les collections végétales de la Confédération, conservées à basse température, dont une partie est régulièrement remise en culture.
Dans le cadre de l’Agroscope, plusieurs programmes de sélections traditionnelles sont en cours : sélection de soja, de pommiers, d’abricotiers et de poiriers, de blé tendre, de plantes médicinales et aromatiques, de plantes fourragères pour prairies temporaires, de graminées fourragères et de trèfle.
Agroscope soutient par ailleurs différents projets de sélection d’organisations privées.
A partir des années 1980, les variétés traditionnelles et anciennes de plusieurs espèces ont commencé à être massivement remplacées par des variétés hybrides venant de l’étranger.
Agroscope a alors renoncé à une sélection de variétés hybrides (pour les espèces allogames), parce que pour sélectionner de nouvelles variétés, il est nécessaire d’investir beaucoup de capitaux, de travail, de temps et d’acquérir du know-how ainsi que d’utiliser des méthodes telles que la biotechnologie et la biologie moléculaire (pour pouvoir concurrencer avec les variétés de l’étranger).
Les espèces sélectionnées auparavant par Agroscope étaient principalement le fenouil, l’asperge, la côte de bette, l’échalote, l’oignon, le poireau et le chou. La sélection maraîchère a été abandonnée, mais Agroscope a continué de faire des essais variétaux pour pouvoir donner des conseils aux producteurs, les informer si les variétés sont adaptées au climat suisse, sur les résistances aux maladies…
Indépendamment de l’orientation de la sélection maraichère, il ne faut pas oublier qu’il y a aussi eu un changement des habitudes de consommation. Il y a eu des efforts pour promouvoir une nouvelle gamme de légumes, par exemple des régions asiatiques, pour une diversification alimentaire. Et pour tenir compte de l’évolution du comportement des consommateurs avec les produits de commodité et les petites portions. Il s’agit notamment d’offres telles que les salades « baby leaf », qui sont récoltées à un stade très précoce, préparées et proposées en sachets, ou les « mini-légumes », principalement le chou-fleur, le brocoli et le chou romanesco, qui sont récoltés tôt et livrés en petites portions attrayantes. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi beaucoup plus de ménages individuels et que la demande de produits frais prêts à la consommation a augmenté considérablement.
Nous avons une étroite collaboration avec des producteurs de semences (Zollinger Bio, Sativa, Artha Samen, DSP et Semences de pays par exemple) qui ont continué à sélectionner des plantes maraîchères pour les jardins privés et des producteurs amateurs ou même pour des professionnels. Nous pouvons heureusement encore leur mettre à disposition des semences de la banque de gènes. Et heureusement aussi, les efforts pour conserver des ressources génétiques et la recherche de variétés anciennes et de cultures alternatives ne datent pas d’hier. La banque de gènes a commencé à collectionner des variétés locales et des semences paysannes déjà en 1900. Et nous avons aussi pu redonner ces dernières années des semences à des paysans qui cultivent de nouveau des anciennes variétés de blé aux champs. La collection de variétés potagères, elle, date du début des années 1980.
La Suisse mise sur une production durable, en Bio ou en Production Intégrée, et pourrait livrer pendant la haute saison (avril à octobre) les principaux légumes consommés en Suisse. Le fait que la Suisse est capable de sélectionner et de produire les semences qu’il faut est prouvé par le passé. Le problème est l’importation et le démantèlement des barrières à l’importation. Les producteurs suisses ont un niveau de prix relativement élevé en culture maraîchère par rapport à la production étrangère. Le prix ne peut être maintenu que par la qualité, la proximité du marché et l’approvisionnement régulier du marché en produits frais. D’autre part, il faut aussi tenir compte du comportement des consommateurs/consommatrices d’aujourd’hui.
La thématique des semences est très actuelle, j’espère que les gens commencent de nouveau à prendre conscience d’où vient la nourriture et avec ça, d’où viennent les semences. Même si la situation est différente chez nous qu’en Afrique, où les semences jouent encore un rôle plus important que chez nous.
Seb – Chaperon vert
Seb est maraîcher et semencier artisanal à Annecy, au sein de l’AMAP du Chaperon vert. Une AMAP est une association de producteurs liée à des consommateurs par contrats. Le Chaperon vert fait partie de la Maison des Semences Paysannes de Haute-Savoie, dans le cadre de laquelle est planifiée collectivement leur production de semences.
Qu’est-ce qui t’a amené à être paysan, et à produire tes propres semences ?
C’est une réflexion sur le sens de mes actions qui m’a amené à devenir paysan. Il n’y avait aucune adéquation entre ce que je faisais avant d’être paysan et les valeurs auxquelles j’étais fortement attaché. Je suis petit-fils de paysans-ouvriers et c’est sans doute aussi les beaux souvenirs de mon enfance qui m’ont mené vers le métier de jardinier. L’idée de produire des semences a germé au gré de rencontres avec d’autres jardiniers et a pris racine grâce à une forte volonté de faire!
Comment choisissez-vous ce que vous cultivez au Chaperon vert ?
Le choix des variétés peut se faire de différentes manières :
- subjectives : le nom, le visuel , le goût…
- objectives : résistance, précocité, tolérance, durée de conservation…
Quelle place la production de semences prend-elle dans l’ensemble de votre activité ?
La multiplication de semences occupe une place importante dans notre jardin. Cette activité est planifiée tout comme la production de plants ou le plan de rotation des cultures.
Et nous sommes actifs au sein de la Maison des Semences Paysannes de Haute-Savoie car il est très important d’avoir des échanges avec d’autres multiplicateurs sur notre territoire. Pas seulement pour échanger des semences, mais aussi pour partager nos expériences!
Comment choisissez vous quelles semences vous allez produire ?
On multiplie certaines semences pour maintenir la variété, d’autres pour sélectionner et/ou améliorer un caractère génétique, mais aussi pour simplement les adapter à notre terroir.
Quelle proportion des semences que vous utilisez provient de votre ferme ou de fermes de votre réseau ?
On multiplie les semences pour la totalité des légumes-fruits de nos jardins. Pour les autres légumes, on doit approcher des 30% de ce que nous mettons en culture.
Est-ce que vous vous risqueriez à n’utiliser que des semences paysannes pour toutes vos cultures ?
C’est déjà ce que nous pratiquons depuis plusieurs années. Nous avons confiance dans les semences paysannes, car elles sont adaptées à notre manière de travailler.
Dans votre ferme, combien gagnez vous en moyenne pour un temps plein ?
1400 euros par mois pour un temps plein.
En général, comment construire des filières alimentaires autonomes, de la semence à l’assiette ?
Nous avons un système de commercialisation qui nous permet une grande liberté. Nous vendons toute notre production sous forme de paniers hebdomadaires de légumes et de fruits à des personnes qui souscrivent et règlent à l’avance un abonnement. Le prix du panier est fixé pour en sortir un revenu décent pour tous les associés du Chaperon vert, tout en réglant tous les frais liés à a production.
C’est nous qui choisissons ce que nous allons mettre dans les paniers. Alors qu’au marché, il est très difficile de vendre autre chose que des potimarrons ou des butternuts, nous pouvons nous permettre de proposer 28 variétés différentes de courges à nos consommateurs. Il en va de même pour beaucoup de légumes ou de fruits. On maintient ainsi une plus grande diversité au sein de nos jardins.
Martin Brüngger – BioBrüngger
Martin est artisan semencier à Courtelary et Safnern dans le canton de Berne. Il produit des semences pour les projets de conservation de l’Office fédéral de l’agriculture, pour Sativa, et pour des maraîchers de la région. Il a aussi un projet pédagogique autour de la semence.
Pourquoi fais-tu ce métier ?
Le contact avec la terre et le travail actif en plein air me ressourcent physiquement et mentalement. Le fait de produire des semences me lie à l’histoire des plantes cultivées. Aussi, je me sens connecté à l’évolution de ces plantes qui nous nourrissent et qui font partie de notre culture. Chaque saison est totalement différente, cette diversité au travail me plait.
Comment le décrirais-tu ?
Je me sens un peu hors du temps. D’abord en raison de la connexion avec le passé et le futur que ce travail implique, et aussi par le fait de faire un métier marginal dans notre société. Les enjeux de génétique, conservation et diversité sont des défis à relever qui rendent mon travail intéressant et croustillant. Je ne me lasse jamais.
Qu’est-ce qui te paraît important pour déterminer des critères de sélection ?
Des plantes robustes, qui produisent bien dans différentes situations, sans qu’elles nécessitent de soins intensifs. Un goût irrésistible. Un caractère spécifique qui différencie une variété des autres.
Sur la base de quelles connaissances travailles-tu ?
J’ai fait une formation universitaire de biologiste, et j’ai ensuite travaillé pendant deux ans à Biosem, une petite structure semencière artisanale dans le canton de Neuchâtel. Les observations dans le quotidien de mon travail, du bon sens et une part d’intuition sont essentiels.
Comment amener les maraîchers à utiliser les semences que tu produis ?
Leur montrer la réalité de notre travail. Etre à l’écoute de leurs besoins. Collaborer avec eux et non pas travailler chacun de son côté. Les impliquer dans la production de semences et les coacher. Etre conscient de nos limites dans la sélection / production.
Qu’est-ce qui empêche, en Suisse, qu’une production de semences destinées à l’agriculture soit rentable par elle-même, sans les apports d’activités annexes ?
La main invisible de l’économie… Les propositions alléchantes des multinationales… La globalisation… …font que les semences sont très peu chères, donc une production suisse est hors concurrence.
Penses-tu qu’il serait possible de changer cette situation, et comment ?
- Par la contrainte : La Suisse se trouve isolée du reste du monde et doit s’organiser de manière autosuffisante…
- De manière active : Par la création d’un réseau bien organisé qui produit des semences de manière contractuelle. Toute la chaîne jusqu’au consommateur est convaincue et paie plus pour la production de semences. Mais même de cette manière, il est peu probable de pouvoir se passer d’aide extérieure.
Quelle proportion de ton revenu provient de la vente de semences aux agriculteurs professionnels ?
Moins de 7,5%. L’essentiel de mon revenu me vient de la production que je fais pour la banque de semences nationale.
Mathieu Buttex – Jardins de Cocagne
Mathieu est jardinier et artisan semencier dans la coopérative des Jardins de Cocagne à Sézegnin.
Quand j’atterris en 2004 aux Jardins de Cocagne, on y cultive déjà la tomate de Chancy. Les semences de cette variété savoureuse aux gros fruits charnus nous ont été offertes quelques années auparavant par une famille habitant le village de Chancy, à quelques kilomètres de là. Depuis combien de temps y était-elle cultivée ? Et l’est-elle encore ? Quel nom portait-elle à l’origine ? Et d’où provenait-elle ? Je l’ignore. Mais l’important, quel que soit son nom, est qu’elle continue à être cultivée et que ses semences continuent de voyager de main en main.
De Chancy, du Vietnam ou d’ailleurs…
Quelques années plus tard, un coopérateur nous ramène des semences d’une autre tomate que son frère cultive en Espagne : la Culo Rojo, ce qui en français se traduirait par « cul rouge ». Une tomate qui ne ressemble à aucune autre : elle reste partiellement verte à maturité si ce n’est le bas de la tomate qui rougit. A ce stade, une fois coupée en deux, elle nous révèle un intérieur parfaitement mûr, d’un rouge grenat intense. Son goût valait la peine que nous la cultivions. Comme pour la Chancy, il nous fallait en faire de la semence si nous ne voulions pas perdre la variété.
Heureusement, produire ses propres semences de tomates n’a rien de compliqué. La tomate est une plante autogame, ce qui veut dire que la pollinisation a lieu dans la fleur sans avoir besoin du pollen d’autres fleurs. Pas besoin donc de se préoccuper d’éventuels croisements. On garde quelques fruits bien mûrs, idéalement pris sur les plus beaux plants, on en extrait la graine et la pulpe que l’on laisse fermenter quelques jours dans un bocal puis que l’on rince à l’eau avant de laisser sécher les semences lavées sur un linge.
Un peu plus tard, c’est un jardinier qui nous ramène des semences d’un voyage au Vietnam. Parmi celles-ci, deux plantes vont attirer notre attention : le Rau Que, un basilic asiatique au goût très épicé et le Tito, une variété vietnamienne de Shiso, qui est une plante aromatique très prisée en Asie. Pas moyen de retourner au Vietnam chercher des graines, il nous faut les reproduire.
Cette fois, il ne s’agit pas de récolter un fruit et d’en extraire les graines. Il faut laisser la plante fleurir (ces deux plantes sont récoltées et consommées avant floraison) et mûrir ses graines, avant de la récolter séchée, de la battre et de séparer la semence des débris de feuilles et de tiges.
Le Shiso et le Rau Que sont des plantes allogames qui ont à tout prix besoin d’être croisées avec un autre individu, au risque de souffrir de consanguinité. Dans le cas de ces deux plantes, ce sont les abeilles et autres insectes butineurs qui vont servir d’intermédiaire au croisement entre deux individus, en transportant le pollen d’une plante sur le pistil d’une autre.
Il faut également empêcher le croisement entre le Rau Que, qui est un basilic vietnamien et le basilic de Gênes, dit aussi basilic vert, et qui est lui italien, mais qui ont tous deux pour origine le même parent asiatique Occimum basilicum, malgré l’éloignement géographique des deux variétés.
Afin d’éviter ce croisement, il nous faut pratiquer l’isolement, soit géographique soit temporel de la variété dont nous souhaitons produire la semence. La distance recommandée d’espacement entre deux plantes de la même espèce pour une production semencière est de 1000 mètres, soit la distance maximale que semblerait parcourir une abeille afin de se nourrir. Cette distance peut-être sensiblement réduite si le terrain comporte des obstacles tels que haies ou tunnels. Mais le meilleur obstacle pour un butineur, ce sont encore les fleurs, sauvages ou cultivées, disséminées alentour. Dès lors une centaine de mètres peut largement suffire. L’isolement temporel, quant à lui, se borne à semer les deux plantes à deux moments différents, pour qu’elles ne fleurissent pas en même temps.
Le choix de l’autonomie, pour la diversité !
L’installation d’une serre à plantons, ainsi que l’acquisition d’une motteuse, nous ont permis d’augmenter le nombre de plantons que nous produisons nous-mêmes pour le jardin, qui se limitait jusque-là à quelques tomates et courges. Le reste est acheté à des fabricants de plantons « professionnels » qui utilisent des semences « professionnelles » destinées à des maraîchers « professionnels ». Ces derniers produisent rarement plus de 10 légumes différents sur leur exploitation, souvent moins, parfois même un seul. Ils destinent leur production à la grande distribution qui exige des produits « irréprochables » et bon marché.
Les variétés modernes sont donc sélectionnées pour répondre aux critères suivants : facilité de récolte : non pas pour rendre le travail moins pénible, mais pour réduire les coûts de production ; rendement : celui-ci se calcule en poids et reflète bien plus la teneur en eau d’un aliment que sa valeur nutritive ; homogénéité : deux individus d’une même variété ne doivent pas pouvoir se différencier et si c’est le cas, ils sont éliminés ; maturation simultanée afin que la récolte se fasse en un seul passage ; bonne tenue après récolte permettant de ce fait le transport sur de longues distances. Qui plus est, la quasi-totalité de la sélection se fait en agriculture chimique dite conventionnelle, sélectionnant ainsi des plantes dépendantes des herbicides, pesticides, fongicides et engrais minéraux.
Pour des raisons économiques, ces fabricants de plantons « professionnels » n’utilisent que les semences calibrées que lui offrent les semenciers, réduisant d’autant l’offre variétale.
Produire ses propres plantons, c’est donc avoir accès à une plus grande diversité de semences en pouvant utiliser des semences qualifiées d’«amateur » par les professionnels, vendues par les petits semenciers peu nombreux mais toujours présents. Ceux-ci continuent la sélection de variétés dites anciennes ou paysannes et œuvrent à la création de nouvelles variétés adaptées à l’agriculture biologique. Ils offrent des variétés reproductibles par tout un chacun, contrairement aux hybrides F1 de l’industrie semencière.
Mais l’offre variétale, même augmentée, reste pauvre. Ainsi, en 2010, on ne trouve en Suisse que trois variétés d’aubergines sélectionnées en Bio : la Violette et la Rotonda bianca sfumata di rosa, chez Sativa et l’Obsidienne chez Zollinger. L’aubergine n’est pas un légume d’une grande importance économique en Suisse. Le marché est majoritairement approvisionné par les productions des pays méditerranéens.
A la recherche d’une aubergine
Aux Jardins de Cocagne, nous cherchons donc d’autres variétés sous d’autres cieux, toujours à pollinisation ouverte, et en essayons 17 sur quelques années parmi lesquelles nous garderons les variétés suivantes : Barbentane et Dourga, deux variétés françaises ; Diamond, d’origine ukrainienne ; Thaï Long Green, variété thaïlandaise ; Mitoyo, originaire du Japon ; Aswad, d’Irak et Apple Green, du Canada. Ces variétés n’étant pas disponibles en Suisse, nous en faisons la semence et par ce biais nous efforçons de les acclimater à nos conditions de culture. Nous découvrons des formes et des couleurs insoupçonnées chez l’aubergine : blanche, verte, rose, bicolore ; longue, ronde, côtelée. Et bien entendu, des textures et des goûts différents pour chaque variété. Mais aussi des plantes d’une plus grande précocité et par conséquent mieux adaptées à nos étés relativement courts.
Nous réessayons la culture en plein air, qui nous avait peu convaincus quelques années auparavant, espérant de meilleurs résultats avec les variétés les plus précoces. Le test s’avère concluant sans être exceptionnel : il est possible de produire des aubergines en plein champ chez nous, mais les rendements sont nettement moindres qu’en tunnel.
Nous sélectionnons donc les plus beaux plants, c’est-à-dire ceux qui se développent bien en conditions extérieures et semons les graines issues de cette sélection l’année suivante. Là, nous procédons à des croisements entre différentes variétés : Diamond x Dourga, Dourga x Thaï Long Green, Obsidienne x Apple Green, etc. Nous laissons mûrir une dizaine de fruits et récoltons les graines. Nous cultivons deux ans de suite la descendance de ces croisements en continuant à sélectionner les meilleures plantes et là la productivité augmente de manière flagrante, dépassant pendant quelques semaines la production en tunnels. En même temps les étés de ces deux années ont été caniculaires et auraient pu profiter aux aubergines extérieures. Il se pourrait également que la sélection ait porté ses fruits. Il faudra davantage d’étés pour le savoir. Mais en tous les cas, la production en plein air est bonne pour un fruit réputé ne se produire bien que sous tunnels sous nos latitudes.
Le travail n’est pas pour autant terminé. Il s’agirait maintenant de refaire un croisement incluant un maximum de plantes différentes afin d’obtenir ce que l’on appelle un pool génétique. Une plante pourrait ainsi avoir 3 ou 4, voire davantage, de variétés comme parents.
Ensuite, tout en continuant la sélection pour l’adaptabilité aux conditions extérieures, appliquer d’autres critères tels que la forme, la couleur et le goût des fruits, l’absence sur le pédoncule de piquants, qui sont agressifs envers les récolteurs.
En sélectionnant simplement les plantes les plus précoces et productives, mais aussi celles en meilleure santé et de belle apparence, nous sélectionnons des plantes capables, grâce à un système racinaire puissant, d’aller chercher elles-mêmes dans le sol les nutriments dont elles ont besoin, et ce tout au long de leur cycle de croissance. Nous sélectionnons des plantes résistantes aux ravageurs et aux maladies. Nous sélectionnons enfin des plantes adaptées à l’agriculture biologique ainsi qu’à nos conditions de culture, notre climat, notre sol, ce que d’aucuns appellent le terroir.
Le fait d’être capables de produire nos propres semences nous permet de cultiver des variétés originales introuvables en Suisse.
Charlotte Aichholz, Noémi Uehlinger et Amadeus Zschunke – Sativa
Sativa est une entreprise semencière artisanale biologique et biodynamique située dans le canton de Zürich. En association avec d’autres entreprises européennes, elle a développé une offre très complète de semences sélectionnées pour l’agriculture biologique. Toutes les variétés de son catalogue sont reproductibles. Charlotte et Noémi sont sélectionneuses à Sativa. Amadeus est directeur.
Pourquoi fais-tu ce métier ?
Noémi : Je suis fascinée par le potentiel, presque un peu magique, que représente chaque graine: cette petite entité concentre en elle-même la faculté de germer et de se lier à l’environnement qui l’entoure, et contient toutes les informations qui détermineront l’espèce, mais aussi la variété que la plante deviendra. De plus, je trouve passionnant d’accompagner les plantes « de la graine à la graine ». Particulièrement pour ce qui est des plantes cultivées, encore plus pour celles dont nous ne mangeons pas la graine, la culture semencière requiert de nombreux gestes justes au bon moment, sans lesquels les plantes n’arriveront pas à produire de la semence de qualité. On peut apprendre une partie de ces règles, mais c’est aussi beaucoup grâce à l’observation et l’expérience qu’on comprend toujours mieux les différentes cultures. Enfin, le fait de travailler ensemble avec mes collègues et d’autres partenaires à une alternative biologique et à taille humaine dans un domaine globalement concentré et trop souvent lié à des multinationales de l’agro-chimie est pour moi une grande motivation. A mes yeux, Sativa a un devoir de communiquer et transmettre ses connaissances là où elle peut soutenir d’autres acteurs soucieux d’une souveraineté semencière.
Charlotte : J’ai découvert ma passion pour les plantes comme adolescente en faisant pousser en premier des plantes sur le balcon et après sur une parcelle biologique proche de la ville où j’ai grandi. Je savais que je pouvais bien m’occuper des plantes et comme je m’intéressais aux sciences du vivant, j’ai choisi les études d’horticulture. Lors de mes cours, la sélection variétale et la génétique m’intéressaient en particulier, car je voyais l’utilité directe pour les agriculteurs et la possibilité de développer quelque chose de nouveau en utilisant les ressources naturelles. Je fais ce métier car j’apprécie beaucoup la synthèse entre la pratique au champ, travaillant avec la nature, l’observation des plantes et la partie scientifique où il faut développer des concepts pour arriver à ses buts. Je vois une grande nécessité de fournir des semences de variétés bio. Dans le futur nous devons de plus en plus faire attention aux systèmes naturels et je pense que je peux y contribuer avec de bonnes variétés bio.
Comment le décrirais-tu ?
Noémi : Le métier de sélectionneuse (ou obtentrice) implique tous les aspects liés à la production légumière et à la production semencière. Je planifie les semis sur la base de ce que je veux comparer au champ et croiser ensuite. J’échange beaucoup avec le responsable des cultures et j’effectue différentes évaluations durant leur croissance, je sélectionne les plantes ou les parcelles à maturité, je transplante les porte-graines* dans des tunnels, j’effectue les croisements lors de la floraison et je continue à discuter avec la responsable des cultures jusqu’à la maturité des graines. Finalement, je récolte les graines, les nettoie et les calibre* afin qu’elles soient prêtes pour un nouveau semis. J’écris « je », car c’est à moi de coordonner toutes les étapes, mais en réalité, de nombreux collègues réalisent le travail avec ou pour moi. Mieux je connais la culture et ses aspects-clés, plus je fais les choix justes au bon moment. Personnellement, j’apprécie beaucoup d’alterner entre travail pratique (au champ ou en tunnel) et travail de planification, recherche ou analyse. Enfin, mon travail me met en lien avec de nombreux acteurs de la filière bio : maraîchères, transformateurs, distributeurs, mais aussi autres sélectionneurs, chercheuses et scientifiques.
Charlotte : La sélection variétale est un métier fascinant, car il a déjà existé depuis que les hommes ont commencé à cultiver la terre. Avec notre métier, nous participons au processus de l’évolution des plantes cultivées. En choisissant les meilleures caractéristiques, nous pouvons influencer quels fruits et légumes les prochaines générations vont manger. Par exemple la salade, comme nous la connaissons, existe seulement à peu près depuis 200 ans, une période très courte, en regard de l’histoire de l’évolution. Une nouvelle culture a été développée par les décisions des sélectionneurs, suivant les besoins des humains.
Comment déterminez-vous vos critères de sélection ?
Noémi : Les critères agronomiques (rendement commercialisable, vigueur, robustesse) et de qualité (optique, gustative) ont généralement une grande importance. La manière dont nous déterminons les critères de sélection dépend fortement du projet. Dans un projet collaboratif entre différents acteurs de la filière (par exemple une variété de carotte pour petits pots pour bébés ou une variété de tomate pour la transformation en sauce), les critères de chacune et de chacun sont amenés et pris en compte dès le début. Dans un projet de diversification, on peut se permettre de commencer par réunir une grande diversité variétale et de chercher plutôt une perle rare, par exemple une forme ou une couleur particulière.
Sur la base de quelles connaissances travaillez-vous ?
Noémi : Tous les obtenteurs/obtentrices de Sativa ont un diplôme universitaire en sélection des plantes. Nous nous appuyons donc en grande partie sur des connaissances et des principes des sciences naturelles (génétique, méthodes de sélection, physiologie, phytopathologie). Ensuite, les connaissances internes de l’entreprise, à travers la longue expérience de certains collègues dans la production de semence biologique, ne sont pas à négliger. Le réseau des sélectionneurs et multiplicatrices de semences biologiques nous livre également régulièrement des impulsions précieuses. Enfin, Sativa est une entreprise biodynamique* et nous cherchons à enrichir notre approche des plantes et de notre travail par cette vision holistique.
Comment amener les maraîchers à utiliser vos semences ?
Noémi : Les caractéristiques d’une certaine variété sont certainement un facteur très important dans le choix (ou non) d’une variété Sativa. Nous n’avons pas encore dans tous les segments nos propres variétés répondant aux critères de rendement, résistances ou homogénéité auxquels les maraîchères et producteurs sont habitués. En général, plus le circuit est long, plus les critères sont élevés et stricts. En opposition, plus le lien avec les consommateurs est fort, plus la productrice peut intégrer des variétés diverses, même si moins « performantes », à sa production. Il y a quelques années, la qualité technique des semences était aussi un frein à l’utilisation de nos variétés. En effet, peu de maraîchers produisent leurs jeunes plants eux-mêmes. Pour un producteur de jeunes plants, la semence de salade doit être enrobée* et celle de céleri pré-germée* et enrobée. Ces dernières années, nous avons beaucoup investi pour développer des techniques certifiées bio pour enrober et faire pré-germer les semences. Comment amener les maraîchers à utiliser nos semences ? Je crois que pour l’instant, nous devons d’abord travailler à nous faire connaître auprès des maraîchers intéressés par une certaine diversité culturale et un approvisionnement en semence alternatif aux grand semenciers conventionnels.
Qu’est-ce qui empêche, en Suisse, qu’une production de semences destinées à l’agriculture soit rentable par elle-même, sans les apports d’activités annexes ? Pensez vous qu’il serait possible de changer cette situation, et comment ?
Noémi : En ce qui concerne les grandes cultures, comme par exemple les céréales, la production de semences en Suisse est rentable. Pour ce qui est des espèces potagères, plusieurs facteurs rendent leur production semencière difficilement rentable : chaque espèce a des exigences différentes en matière de climat. De nombreuses espèces préfèrent un climat sec, pas trop chaud, et bien aéré. C’est pourquoi il existe des régions historiquement semencières, comme le Nord de l’Italie, la Bretagne ou le Pays de la Loire en France. En Suisse, certaines de ces cultures doivent être conduites sous abri, ce qui rend leur production plus coûteuse. Enfin, en Suisse, nous n’atteignons par exemple pas les calibres de semence de carottes que nous récoltons en France ou en Italie.
Le coût supérieur de notre production n’est pas une fatalité : Il est, d’un côté, lié aux exigences élevées des productrices et ces exigences sont elles-mêmes étroitement liées aux structures agricoles actuelles. Un exemple : les producteurs de carottes sèment normalement de la semence de calibres 1.8-2.0 mm et 1.6-1.8 mm. Sur 100 kg de semence brute bio de carottes, environ 15 à 25 kg répondent en moyenne à ces deux calibres. Cependant, tous les systèmes de production ne sont pas aussi exigeants. Dans des circuits plus courts, moins mécanisés, plus dépendants du travail manuel, une production à partir de calibres plus bas serait tout à fait envisageable. Par ailleurs, on peut se demander pourquoi, de manière générale, notre agriculture n’est pas rentable en tant que telle. En effet, l’agriculture en général est soumise à une pression des prix qui n’est pas juste, dans tous les sens du terme : de nombreux coûts sociaux et environnementaux sont encore externalisés, la majeure partie de la production agricole est « indifférenciée », ce qui rend la production de l’agriculteur A équivalente à celle de la productrice B, quelques grands acteurs pouvant faire jouer une concurrence entre les producteurs et dicter des prix toujours plus bas… Dans un autre modèle agricole à taille humaine et écologique, une semence « régionale » ne serait pas impensable.
Quelle proportion du revenu de l’entreprise provient de la vente de semences aux agriculteurs professionnels ?
Noémi : Si on définit un agriculteur professionnel comme une personne tirant un revenu de son activité agricole, un peu plus de la moitié de notre chiffre d’affaires provient de la vente aux professionnels.
Quel est le fonctionnement économique de Sativa ?
Amadeus : Notre travail, en particulier celui de la création variétale et de la sélection de conservation, est un travail coûteux en temps et en argent. D’un point de vue purement économique, les coûts sont fortement supérieurs à ce que pourrait permettre notre chiffre d’affaires.
La partie commerciale de Sativa, c’est-à-dire la vente de semences, doit être rentable. Ceci exige beaucoup d’efforts, mais c’est la réalité que connaît toute entreprise. C’est la raison pour laquelle nous devons constamment adapter notre assortiment et retirer certaines variétés de notre offre, parce qu’elles sont vendues en trop petit nombre. Jusqu’à présent, le nombre de variétés dans le catalogue a cependant sans cesse augmenté.
Dans l’autre partie de Sativa, c’est-à-dire celle de la création variétale, nous pouvons faire autant que ce qui est financé. Cela signifie que nous devons calculer et planifier le travail à nouveau chaque année. L’entreprise couvre une partie des dépenses, entre autres à travers l’infrastructure, qui est financée par les bénéfices de la vente de semences et mise à disposition des sélectionneurs/sélectionneuses. La station de nettoyage, par exemple, dispose de toutes les machines nécessaires et peut être utilisée par les sélectionneurs/sélectionneuses pour nettoyer et calibrer leur semence.
A côté de cela, nous avons besoin d’un financement externe, qui représente aujourd’hui env. 2/3 du budget de la création variétale. Notre travail est possible uniquement grâce au soutien de nombreux partenaires. Nous faisons des demandes de financement auprès de fondations ou recevons des soutiens financiers d’entreprises de la filière bio. Ces dernières nous demandent de développer des variétés dont elles ont besoin, comme par exemple des tournesols adaptés aux conditions de culture bio.
Un autre soutien vient des producteurs/productrices bio, qui acceptent de nous mettre à disposition des terrains pour un prix avantageux.
Sativa est une société anonyme. Elle est soutenue par env. 450 actionnaires. Un tiers des actions appartiennent à des employés de Sativa. Plusieurs fondations ont aussi des actions. La majorité des actionnaires sont des clients de Sativa. Ils soutiennent notre travail en mettant à disposition du capital dont nous avons besoin pour notre travail, tout en attendant des rendements d’abord idéels (Sativa ne paie pas de dividendes).
Nos collaborateurs et collaboratrices apportent aussi une contribution importante. Avec la taille actuelle de l’entreprise, les activités sont plus divisées qu’il y a 15 ans. Si on prend la moyenne des salaires, on peut dire que nos collaborateurs/collaboratrices gagnent env. 20-30% moins que ce qu’ils gagneraient en Suisse pour un travail semblable.
Joël Mützenberg – Semences de pays
Joël est artisan semencier dans l’association Semences de pays, à Genève.
Comment est née l’association Semences de pays ?
Genève, pendant plusieurs siècles, est un lieu important de culture maraîchère. De nombreuses variétés de légumes naissent du patient travail des maraîchers semenciers de la région.
L’activité semencière disparaît par la suite de notre canton, le maraîchage genevois étant profondément transformé par l’agro-industrie et ses solutions miracles : semences hybrides, pesticides, hors-sol. Dans les années 80 déjà, seulement 2% des semences de légumes semées en Suisse y sont produites. L’avenir radieux que nous promet la révolution verte montre petit à petit ses dimensions cauchemardesques et suscite la résistance des paysans du Sud, auxquels se joignent ceux du Nord, formant ensemble la Via Campesina, organisation mondiale porteuse du projet de souveraineté alimentaire. Par ailleurs, en Suisse, ProSpecieRara travaille à la sauvegarde des variétés anciennes en mobilisant entre autres les jardiniers amateurs qui s’inquiètent de la perte de biodiversité. A Genève, sur l’exemple des Jardins de Cocagne, se développe progressivement un chapelet d’initiatives agricoles contractuelles de proximité (ACP), forme de distribution qui permet une production locale diversifiée et donne aux habitants de la région la possibilité de décider ce qui sera cultivé, comment et dans quelles conditions sociales. Logiquement, toutes ces ACP font le choix de l’agriculture biologique.
L’association Les Artichauts est créée en 2008 pour fournir à ces ACP des plantons bios. Et, finalement, en 2009 apparaît notre association, Semences de pays, pour compléter cette filière en produisant localement des semences de variétés adaptées à l’agriculture biologique, dans les conditions climatiques de la région, et en relation avec les pratiques culturelles vivantes qui nous entourent. Nous connaissons les champs dans lesquels poussent nos variétés et les prénoms de celles et ceux qui les cultivent.
Qu’est-ce qui t’a amené à produire des semences ?
L’organisation de notre vie quotidienne nous échappe. Nous ne construisons pas les maisons que nous habitons, trouvons notre nourriture dans les supermarchés, et nos médicaments dans les pharmacies.
Nous sortons de l’école secondaire incapables de nous nourrir par nous-mêmes, de nous soigner par nous-mêmes ou de nous construire un toit. Ceux qui ont vraiment leur mot à dire sur notre vie quotidienne, ce sont les promoteurs immobiliers, les industriels, les assurances, les banques et la grande distribution. Je n’ai jamais accepté cette situation. Travailler à Semences de pays, en lien avec d’autres personnes de la région s’organisant pour leur souveraineté alimentaire, me permet d’essayer de mettre fin à cette dépendance.
Comment décrirais-tu ce métier ?
Le travail artisanal de produire des semences maraîchères est en partie le même que celui de cultiver des légumes. Dans les champs, une différence importante est que nous laissons certaines plantes pousser beaucoup plus longtemps pour qu’elles poursuivent leur développement jusqu’au stade de la reproduction, c’est-à-dire de la graine. De plus, ces plantations doivent être organisées dans le temps et l’espace de manière à éviter certains croisements. Mais surtout, le travail de culture est accompagné en permanence d’un travail d’observation, sur lequel se basent nos sélections.
Au sein même de chaque variété, chaque individu est différent. Si on choisit de laisser monter en graine la moitié des choux qui a les feuilles les plus foncées ou celle qui a les feuilles les plus claires, la nouvelle génération qui en découlera sera différente. Nous pouvons ainsi, juste en choisissant quelles plantes garder pour la production de semences, amener progressivement une variété à se transformer. Ces transformations survenues dans les variétés sont la conséquence de nos choix parmi des possibilités préexistantes dans les plantes. Elles se sont produites de par l’activité des plantes elles-mêmes. Elles leur appartiennent. Notre lien avec nos variétés est purement affectif. Ce lien s’insère dans une longue histoire, commencée il y a des siècles, que nous continuons.
Sur quelles bases déterminez-vous vos critères de sélection ?
Notre sélection se base sur ce que les plantes nous montrent, sur ce que les personnes qui les ont sélectionnées par le passé nous racontent et sur les exigences des personnes qui vont les cultiver. Ainsi, d’une part nous cherchons à connaître les critères de sélection des paysans ou des artisans semenciers dont nous avons repris les variétés, pour travailler en continuité avec leur sélection. Pour cela, nous avons privilégié les variétés sélectionnées par notre voisin François Grosjean ou par des maraîchers de notre entourage, qui peuvent nous transmettre, en même temps que les graines, les connaissances qui les accompagnent. D’autre part, nous cherchons à connaître l’avis des personnes qui pourraient par la suite cultiver ces variétés ou les manger, pour que cette sélection soit celle de la filière alimentaire dans laquelle nous nous inscrivons. Nous avons donc, depuis les débuts de Semences de pays, observé nos variétés avec les maraîchers qui les cultivaient, parfois sélectionné avec eux, et organisé des comparaisons gustatives. Mais la mise en place d’un processus systématique de sélection collective prendra beaucoup de temps et nécessitera une appropriation des enjeux de sélection par tous les échelons de la filière.
Comment construire des filières alimentaires autonomes, de la semence à l’assiette ?
Malgré la disparition d’innombrables variétés locales depuis le début du 20ème siècle, il y a encore bien assez de variétés reproductibles de qualité et capables des variabilités nécessaires pour être cultivées dans une grande diversité de terroirs. Beaucoup de ces variétés sont encore aux mains des paysans, principalement dans les pays du Sud, et chez les semenciers artisanaux dans les pays du Nord.
Mais pour que ces variétés continuent à exister et ne se détériorent pas, il faut les utiliser. Or, la concentration de la propriété de la terre, et l’industrialisation de la production qui va avec, impliquent un choix variétal très restreint.
Si un maraîcher qui a un pouvoir de décision sur ce qu’il produit peut choisir ce qu’il va cultiver, ce n’est pas le cas de celui qui livre ses légumes aux grandes chaînes de distribution. Actuellement, en Suisse, les chaînes de supermarchés sont en position d’imposer leurs conditions même aux structures agricoles les plus grandes. Seules les petites exploitations, qui peuvent écouler toute leur production dans des circuits courts, peuvent réellement choisir ce qu’elles cultivent.
En Europe occidentale, où les paysans ont à quelques exceptions près cessé de produire leurs propres semences depuis plusieurs décennies, cela signifie réapprendre à choisir ses semences et à en produire. C’est une tâche difficile car, pour les paysans du 20ème siècle, c’était devenu totalement normal que les agronomes leur disent quoi semer, et quand, et leur prescrivent les doses et dates de traitements.
Ce qui manque donc pour remettre en route des productions de semences artisanales destinées à l’agriculture, ce sont des paysans qui les cultivent! C’est une agriculture paysanne, avec ce que cela signifie d’autonomie des choix culturaux et d’indépendance au niveau de la distribution. Une agriculture qui ne court pas après les tendances, mais se construit en incluant l’ensemble des personnes concernées.
En effet, une filière alimentaire autonome n’est possible que si les différents maillons de la chaîne réfléchissent ensemble au système alimentaire qui les relie. Et pour que réellement cette réflexion se mène ensemble, les consommateurs doivent comprendre les tenants et aboutissants de la production. Si leur expertise augmente, ils peuvent dépasser le rôle qui leur est assigné habituellement de choisir entre le bio industriel qui a parcouru des kilomètres, l’agro-industrie locale, ou tel stand sur le marché auquel ils se fient parce que le vendeur a une bonne tête ou un bon label.
Alors qu’une poignée de multinationales se partage le monopole des semences, imposant un modèle d’agro-industrie dévastateur, Semences de pays participe à la construction d’un système alimentaire local et solidaire. Produire collectivement la nourriture que nous voulons est la base de l’autonomie de tout regroupement humain. L’activité de Semences de pays ne prend sens que dans une dynamique d’intégration paysanne régionale participant à un mouvement global d’émancipation.
Uphorbak – Sénégal
Entretien avec des artisans semenciers d’Uphorbak. Uphorbak est une association de maraîchers du Nord-Est du Sénégal, qui travaille sur les semences locales. L’entretien débute dans le bureau de l’association, avec Samba Kâ, secrétaire général et Moussa Ndiaye, technicien.
Moussa Ndiaye : Nous avons toujours dit « producteur de semences » mais le nom « artisan semencier » est excellent. Nous l’adoptons.
Samba Kâ : Nous avons formé des artisans semenciers qui sont aujourd’hui libres de tous mouvements. Nous devons utiliser la filière, être en amont et en aval. Et ainsi conduire la barque sans chavirer.
L’artisan semencier est normalement lui-même producteur. Cela rassure les autres producteurs, car c’est un pair. C’est le gage de la qualité du produit proposé. Dans le programme de l’association, nous voulons qu’il y ait un artisan semencier au niveau de chaque exploitation et ainsi ne fonctionner qu’avec les semences produites par les artisans.
Il nous faut faire un inventaire des semences disponibles pour construire un catalogue et examiner les spécificités et qualités de chaque espèce. Cela permettra d’identifier les semences recherchées par les différents acteurs et de les installer dans les marchés. Suite à nos recherches sur le marché, nous avons identifié quels types de piments sont recherchés.
Avec la mondialisation, la semence traditionnelle peut être détournée et produite ailleurs.
Moussa Ndiaye : Ceux qui pensent aujourd’hui qu’ils auront la possibilité de breveter des semences n’ont pas encore gagné. La première chose à faire est de rassembler l’information et de connaître son patrimoine. Par exemple le violet de Galmy, oignon traditionnel de la région, a été reconnu comme local et ne peut être breveté par les firmes.
Samba Kâ : Nous ne sommes pas intéressés par les transactions financières autour des semences. Nous souhaitons qu’entre artisans la production soit pérenne. Comme nous sommes liés à une logique économique, nous devons parfois lâcher, mais la question centrale est, pour nous, la souveraineté alimentaire.
Moussa Ndiaye : Depuis 10 ans, nous constatons que nos semences sont adaptées au changement climatique. La pratique de l’artisan semencier, qui fait retourner la semence à la terre, permet de garantir l’évolution des semences. C’est la pratique paysanne qui permet l’adaptation au changement climatique.
Arrivée d’Abdoulai Ly et de Mamadou Barra, artisans semenciers membres de l’association.
Abdoulai Ly : Les producteurs ne sont pas sûrs des semences locales. Quand on dit locales, certains doutent. Quand ils essaient, ils s’y retrouvent.
L’écoulement de la production, l’absence de label, les outils inadéquats posent problème. Nous voulons également le renforcement des capacités par des formations pour être plus solides.
Quand c’est bio, parfois il y a trop d’attaques. On réagit avec les moyens du bord, eau savonneuse, cendres, mélange piment et ail. Le savon repousse beaucoup d’insectes. Cela tue les vers. Les fruits du nim sont aussi efficaces.
Mamadou Barra : Les semences traditionnelles ne changent pas. Les semences importées ont une durée de vie limitée. Quand on perd les semences traditionnelles, c’est une valeur qui s’en va. Avec les hybrides, il faut tout le temps racheter des graines.
Nos semences, nos pères les ont trouvées, leurs pères les ont trouvées, elles sont toujours intactes. C’est le gros avantage. C’est également important au niveau symbolique de s’inscrire dans une lignée.
Samba Kâ : Il faut travailler à l’échelle familiale, locale et nationale. Le meilleur moyen de conscientiser la population, c’est l’échelle du village. Maintenant, il nous faut essayer de travailler à l’échelle nationale.
L’association permet de regrouper les producteurs face aux intermédiaires. Nous créons le lien entre artisans. Quand cela est fait, l’artisan peut donner ou vendre à un prix qui ne soit pas excessif. Nous demandons à nos membres de ne pas être dans une logique marchande. Nous suggérons de ne pas l’être.
Abdoulai Ly : Pour le piment, d’abord on récolte, mais surtout on sélectionne. Il faut casser, mettre dans l’eau. On remplit les deux bassines, on met de l’eau jusqu’au lendemain. Il faut ensuite sortir les graines, filtrer l’eau. Puis sécher et trier. On amène ensuite les graines aux techniciens.
Moussa Ndiaye : Je fais le test de germination. Quatre fois cent graines. Je compte les levées. Comme ce n’est pas certifié par la recherche, on ne peut pas l’écrire sur l’emballage, mais l’information circule bien au niveau local.
L’entretien se poursuit dans les champs, en commençant par une visite à Mamadou Gueye, dans son champ au bord du fleuve Sénégal.
Mamadou Gueye : Je récolte tous les dimanches mes piments. La récolte dure quatre mois. J’ai arrêté les traitements des plants depuis longtemps. Ce n’est pas bon pour la santé. Et c’est cher.
J’ai acheté des graines l’an dernier, maintenant je fais mes semences. Les graines prennent le climat. Elles s’adaptent. Ça te fait moins de dépenses. On n’avait pas cette expérience avant. J’ai fait plusieurs formations et maintenant je produis toutes mes semences. Maintenant, c’est plus rentable. Les oignons sont plus gros car ils sont adaptés. Après deux campagnes, j’ai vu la différence. Je produis deux fois plus qu’avant depuis que je fais mes graines.
C’est très difficile de faire la pépinière avec les graines achetées, car elles ne montent pas. Avec mes graines, c’est du 100%. On plante d’abord au bord du fleuve pour faire monter les graines, puis on transplante dans les champs.
On se déplace à nouveau, autour de nous poussent papayers, aubergines, manioc, poivrons, bananiers, piments antillais, piments Big-Sun, piments Sofia et piments Bombardier, persil, basilic, courges, menthe, choux, laitues patates, maïs, patate douce, tomates, betteraves, concombre rholinié, aubergine amère et niabé. Nous rencontrons Isaa Coulibaly et d’autres cultivateurs, toujours avec Moussa, le technicien de l’association.
Moussa Ndiaye : Les piments et les papayers sont plantés ensemble. Les papayers jouent le rôle de brise vent et protègent les piments du soleil pendant la saison chaude. On mélange choux et tomates. L’ennemi des choux mange l’ennemi des tomates. L’ennemi des tomates mange l’ennemi des choux.
Isaa Coulibaly : Il y a 5 ans, on a commencé avec un petit jardin. Avant, on ne produisait pas tant. On a étudié et conclu que l’on pouvait avoir des récoltes toute l’année.
On mélange les arbres avec les légumes. Tu plantes des papayers avec d’autres légumes. Toute l’année on récolte avec ce système. Janvier, piments, puis patates et navets. Ensuite c’est les oignons. Si le piment ne marche pas, l’aubergine arrive, si l’aubergine ne marche pas, c’est l’aubergine africaine, puis l’oignon, etc. La papaye produit toute l’année, après 8 mois de croissance.
Moussa Ndiaye : Il n’a pas d’autre métier, c’est le jardin et il s’en sort !
Isaa Coulibaly : Non, je n’arrive pas à épargner. Cette année, l’année est difficile. Le prix du piment a chuté, la saison a connu peu d’eau. Il n‘y a pas de subventions de l’état. Le maraîchage est peu subventionné.
Moussa Ndiaye : Comme il n’est pas artisan semencier, il n’a peut-être pas produit correctement. Il travaille différemment sans sortir la graine du piment, mais fait une bouillie. Cela est moins efficace. Il va s’inscrire au programme. Il faut être posé, pas pressé, la semence c’est ça. Il faut observer.
Isaa Coulibaly : Nous sommes ici depuis de nombreuses générations. C’est des terres que l’on ne vend pas. La tradition familiale raconte que l’on s’est battu pour cette terre. Mon grand-père a tout fait pour cette terre, puis mon père est venu. Mon père est décédé, et maintenant nous sommes là.
Arrivée tardive de Daouda Diarra.
Daouda Diarra : Je plante du maïs précoce. Une fois mûr, je récolte et je prends les feuilles pour le bétail. Je brûle le reste et je mélange les cendres à la terre comme engrais, puis je plante les oignons. Le maïs a le plus besoin d’eau, je le plante en premier, car la nappe phréatique est près du sol. Puis, je plante l’oignon, moins gourmand. Je ne fais que les semences d’oignons et de piments.
Des fois on va acheter des pots (les semences du commerce), des fois on prend les semences locales. Les pots ont plus de rendement que les semences que je produis. Quand les piments Big-Sun ne poussent pas bien, je complète avec les semences locales.
J’attends que le piment soit mûr, je cueille les fruits, j’enlève les gaines, puis je fais sécher les graines sous les arbres et je les stocke dans une boîte. Je n’ai pas suivi le cours de production de semences de l’association. Je suis la méthode traditionnelle.
Moussa Ndiaye : La production de graines des artisans semenciers ne suffit pas à combler la demande. Du coup, les semences importées gardent une grande importance.
On finit notre tour par la visite du champ de Samba.
Samba Kâ : Nous avons introduit le potager dans la région. Il y a 15 ans, il n’y avait pas de légumes. Le problème c’est que tout le monde fait la même chose. Si la pastèque se vend cher, tout le monde fait de la pastèque au lieu de diversifier les filières.
C’est une zone inondable. Il faut trouver des solutions adaptées qui prennent cela en compte. L’inondation est une catastrophe, mais on pourrait transformer la catastrophe en opportunité. Comment faire pour utiliser cette eau ? Le riz flottant pourrait être une solution, mais quelle variété ? Comment contenir les fonctionnaires pour pouvoir réellement exister ? Cette année, du riz a été planté. L’inondation l’a détruit. Nous avions travaillé dans le respect du calendrier cultural. On est parti à l’aventure, on a semé à nouveau et on a récolté du riz. Tout cela suppose la disponibilité en semences pour pouvoir tester et innover. On a perdu la première récolte, mais comme on avait nos semences, on a pu replanter en dehors du calendrier et récolter. Moins que prévu, mais assez quand même.
En ce qui concerne la semence d’oignons, nous avons deux organisations de productrices et trois paysans qui sont également des artisans semenciers. Pour les piments, nous regroupons trois artisans semenciers et une organisation de productrices.
Il y a un fort potentiel pour les semences. J’ai 10 hectares d’oignons. Cela représente des kilos de graines. Je veux produire mes propres semences pour l’ensemble. Le but est d’autonomiser la région à long terme. À court terme, il faut former les organisations de productrices locales et les artisans semenciers.
Quand il y a de l’eau, je produis beaucoup de semences. Je peux produire 80 kilos de semences. Celles dont j’ai besoin, environ 4 kilos, et je vends le surplus. C’est très intéressant économiquement. Je peux les vendre largement au-dessous du prix du marché. Je fais de l’oignon et du piment. Ces 80 kilos ne représentent pas le tiers de ce dont nous avons besoin. L’association aurait besoin de 480 kilos.
Tulipan Zollinger – Zollinger
Zollinger est une entreprise semencière artisanale biologique située dans le Chablais valaisan. Elle produit la majorité des semences de son catalogue sur son exploitation agricole. Toutes ses variétés sont reproductibles. Tulipan est artisan semencier à Zollinger.
Pourquoi fais-tu ce métier ?
Je suis littéralement tombé dans les graines par ma famille : mes parents ont fondé notre entreprise semencière en 1984, l’année de ma naissance !
Comment le décrirais-tu ?
Je suis fasciné par la densité d’information que les graines contiennent : ce minuscule volume contient toutes les informations nécessaires au développement d’une plante. Les plantes n’ont bien sûr pas besoin de nous, c’est bien le contraire : nous nous voyons plutôt comme des gardiens-accompagnateurs de nos variétés pendant leur cycle de reproduction.
Comment déterminez vous vos critères de sélection ?
La plupart de nos variétés ont traditionnellement évolué dans les jardins paysans. Une symbiose se formait entre les variétés qui nourrissaient la population, et les cultivateurs qui leur permettaient de se reproduire. Nous essayons de préserver cet esprit en respectant autant les variétés que le travail de nos ancêtres, tout en permettant à ces cultures une évolution et adaptation à des critères de production modernes. Les méthodes de culture, le climat et les préférences des consommateurs changent, et nous « coachons » nos variétés pour ce futur !
Sur la base de quelles connaissances travaillez-vous ?
Notre famille a accumulé quatre décennies de savoir-faire semencier. Mon frère Tizian et moi-même avons complémenté ceci par une partie plus théorique sous la forme d’un master en génétique et sélection de plantes.
Comment amener les maraîchers à utiliser vos semences ?
Nous visons avant tout les petits maraîchers qui font de la vente à proximité. Afin de pouvoir offrir une vraie plus-value à leurs clients, ils doivent offrir des spécialités et des produits qui se démarquent au niveau gustatif, et ils se tournent donc vers nos variétés.
Qu’est-ce qui empêche, en Suisse, qu’une production de semences destinées à l’agriculture soit rentable par elle-même, sans les apports d’activités annexes ?
Notre existence prouve que la production de graines de spécialités est rentable. Pour des produits à haute valeur ajoutée comme les légumes, la part des graines sur les coûts totaux de production est négligeable, mais le choix de la variété a une énorme influence sur la qualité.
Ceci n’est pas le cas pour des denrées comme le maïs ou le blé : la sélection de nouvelles variétés coûte cher, mais la différenciation entre plusieurs variétés est négligeable. Ces coûts ne se laissent amortir que sur d’énormes volumes, et donc, seule une poignée de semenciers peut se spécialiser dans ce domaine.